02/08/2005
Et si le chômeur était une marchandise comme une autre ?
 Notre aimable clientèle d'Emmanuelle Heidsieck
Notre aimable clientèle d'Emmanuelle Heidsieck
En ces temps où l’on discute beaucoup sur la directive Bolkenstein et sur les amendements à lui apporter pour lui permettre de recevoir l’aval de l’Europe entière et de libéraliser une fois pour toutes le dernier bastion de services qui résistent encore et toujours à la privatisation généralisée, voici un roman qui n’hésite pas à franchir allègrement le fossé qui séparait jusqu’ici services publics et commerce. Dans « Notre aimable clientèle », on suit le cheminement de quelques membres du personnel des Assedic de la Région parisienne : Robert Leblanc, employé de guichet, Alain Marty-Terouard qui dirige toute l’institution, et une brochette de ses collaborateurs rapprochés, qui le suivent comme le plancton dérive dans le sillage d’un cachalot. Ils sont tous poussés par le même arrivisme, la même mesquinerie rapace et les mêmes incompétences flagrantes à gérer quoi que ce soit d’autre que leur propre carrière. Dans cet univers de requins, fort proche du monde de l’entreprise moderne, Robert Leblanc fait figure d’amibe ou de mollusque. Il traite les chômeurs avec compassion, tente de bien faire son boulot, sans passion et sans haine. Il cherche aussi à se débrouiller dans sa petite vie de fonctionnaire récemment séparé, veillant sur ses filles en alternance avec sa femme, espérant rencontrer enfin une compagne qui lui convienne. Tout cela est un pue convenu : on croirait contempler une tableau représentant le monde de l’entreprise actuel, avec ses habituels jeux de forces et ses laissés pour compte. Mais ce qui frappe soudain, c’est de se rendre compte que le milieu qui est décrit est celui d’un service public, un service où l’on a décidé de ne plus parler de « chômeurs » mais de « clients », où l’on rationalise et restructure selon les envies de la direction, en fonction des plans de carrière des uns et des autres. Voilà qui donne véritablement le vertige, car derrière chaque client, c’est une vie qui est en jeu ; un revenu, une famille à nourrir, un équilibre brisé qu’il faut rétablir. Malheureusement, Emmanuelle Heidsieck s’est fixé des enjeux narratifs qui la dépassent. N’est pas Jonathan Coe qui veut. Son roman devrait être une démonstration, il réussit à peine à être une illustration. On finit par trouver les personnages fort ternes à force d’être bariolés de tares et de vices, on trouve les rebondissements très plats, car ils passent à côté de l’essentiel : la dimension humaine de tout cela, la seule qui serait à même de cerner l’essence de la distinction entre service public et service clientèle, le fossé salvateur qui sépare service au public et commercialisation des services. Dommage, l’idée était bonne et la fiction était un excellent choix pour traiter de ce sujet. Mieux vaut relire Testament à l’anglaise que plonger dans ce roman-ci.
Emmanuelle Heidsieck, Notre aimable clientèle, roman, Denoël, 140 pp.
11:30 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Un feu follet qui brille dans la nuit
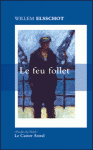
Willem Elsschot, Le feu follet
On ne peut que saluer l’initiative du Castor Astral pour rendre accessibles en français les classiques de la littérature flamande. Des livres écrits au nord de la Belgique qui, malgré le succès critique ou public qu’ils avaient rencontré en Flandre, n’étaient pas accessibles au public francophone, de Belgique comme de France. Soulignons aussi que la ligne éditoriale de la collection ne se contente pas de publier un bouquin par auteur, le plus connu ou le plus réputé, par exemple ; elle suit véritablement le fil de l’œuvre de plusieurs écrivains : Jef Geerarts, Benno Barnard ou… Willem Elsschot, dont elle traduit le troisième roman en l’espace de deux ans ! Après Fromage et Villa des roses, voici Le Feu Follet, un court roman qui marque moins par sa longueur que par l’épaisseur de l’ambiance qui s’en dégage.
Nous sommes en 1930, dans le port d’Anvers, le narrateur, un père de famille dont on ne sait à peu près rien sinon qu’il a décidé de se « ranger » (mais se ranger de quel vice ? se priver de quelles extravagances ? nous n’en saurons jamais rien) dès le lendemain matin de cette nuit étrange où son chemin croise celle de trois marins descendus à terre retrouver une jeune flamande qui a réparé un filet à bord de leur navire, le Delhi Castle. Ils arrivent droit des Indes, parlent anglais et exhibent fièrement une sorte de boîte à cigares, à l’intérieur de laquelle est écrite l’adresse de la jeune fille. Nous sommes en novembre, il fait froid, il fait nuit, un crachin maussade couvre la ville, le narrateur devrait rentrer chez lui et pourtant il va accompagner ces trois hommes à la recherche de Maria Van Dam. Trouver une fille facile dans le port d’Anvers n’est pas chose compliquée, mais retrouver la jeune fille qu’on cherche est une autre entreprise. Les quatre hommes vont ainsi traverser la nuit et la ville sur la piste soigneusement brouillée d’une ravaudeuse de filets.
Elsschot a rassemblé tous les ingrédients pour tisser une ambiance aussi sordide qu’humide : rues sombres, temps de chien, racisme sournois, regards inquiets des étrangers sans repères dans la ville et, surtout, quête impossible de la femme désirée, qui se dérobe avant même d’être approchée. Le quatrième de couverture parle de chef d’œuvre de la littérature du XXe siècle, c’est peut-être un peu forcer l’éloge, mais ce condensé de roman a la densité des grands textes, il est bourré d’interrogations qui poursuivent leur travail dans l’imagination du lecteur et d’images fortes qui sculptent son imaginaire pour longtemps. C’est un tout petit bouquin, qui se lit en une bonne heure à peine, mais résonne très longtemps, comme une chanson de marin, qui trotte en tête bien après qu’on ait quitté le port.
Willem Elsschot, Le feu follet, Le castor Astral, collection « Escales du Nord – Bibliothèque flamande », 92 pp.
10:20 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
26/07/2005
Cavale sur les nationales
 Le quatrième roman de Pierre Ahnne est un film raconté : un road movie déprimé, qui démarre, justement, dans une salle de cinéma parisienne, où le héros ramasse le pistolet automatique abandonné par un spectateur entré en cours de séance, blessé peut-être, épuisé sans doute, venu trouver dans la salle obscure un peu de repos avant de poursuivre sa cavale. Un pistolet automatique, ce n’est pas rien, c’est lourd, c’est noir, c’est compliqué à manipuler. C’est une arme, surtout, et avec un tel objet en poche, le monde ne peut que basculer. Le roman débute le jour de Noël, les rues de la capitale sont vides, on n’y croise que des ectoplasmes en course rapide entre deux fêtes familiales. Le narrateur est seul, il est armé désormais ; son chemin croise celui d’une dame, qui charge dans sa petite voiture un immense paquet cadeau. Et c’est là que tout dérape. Le pistolet sort de sous le manteau, le narrateur s’embarque avec la dame dans la voiture : « j’ai vaguement agité le pistolet et j’ai dit roulez. » C’est parti. Et ça ne s’arrêtera pas de sitôt.
Le quatrième roman de Pierre Ahnne est un film raconté : un road movie déprimé, qui démarre, justement, dans une salle de cinéma parisienne, où le héros ramasse le pistolet automatique abandonné par un spectateur entré en cours de séance, blessé peut-être, épuisé sans doute, venu trouver dans la salle obscure un peu de repos avant de poursuivre sa cavale. Un pistolet automatique, ce n’est pas rien, c’est lourd, c’est noir, c’est compliqué à manipuler. C’est une arme, surtout, et avec un tel objet en poche, le monde ne peut que basculer. Le roman débute le jour de Noël, les rues de la capitale sont vides, on n’y croise que des ectoplasmes en course rapide entre deux fêtes familiales. Le narrateur est seul, il est armé désormais ; son chemin croise celui d’une dame, qui charge dans sa petite voiture un immense paquet cadeau. Et c’est là que tout dérape. Le pistolet sort de sous le manteau, le narrateur s’embarque avec la dame dans la voiture : « j’ai vaguement agité le pistolet et j’ai dit roulez. » C’est parti. Et ça ne s’arrêtera pas de sitôt.
Le ton du roman est celui du monologue dépressif, de la logorrhée maniaque, le narrateur tente d’expliquer ses choix, de justifier son absence de mobile, de trouver réponse à ses propres interrogations et, surtout, de raccrocher sa vie errante à l'image rassurante et stéréotypée du psychopathe de cinéma. Il y a du Meursault dans sa démarche, du Roquentin dans son attitude, mais, si l’on n’est pas loin du roman de l’absurde, on est aussi très près du roman minimaliste dans le droit fil de Monsieur ou de L’appareil-photo de Jean-Philippe Toussaint, où cinéma et interrogations métaphysiques étaient déjà intimement mêlés sur fond de déambulations erratiques.
Tout au long du livre, on ne peut s’empêcher d’imaginer le roman mis en images, avec une musique lente et des paysages hivernaux, des routes nationales balayées par le passage des camions et des visages travaillés par les rides. Couple avec pistolet dans un paysage d'hiver est une métaphore terrible de nos sociétés solitaires, de nos tentatives désespérées pour trouver un sens, des repères, dans un univers où tout se détache, se replie, où rien ne se partage sauf peut-être – et encore – la solitude, justement, et les clichés du mauvais cinéma policier, où les méchants prennent les gentils en otage et s’enfuient jusqu’à ce que la police les attrape. La réalité peut-elle se conformer aux stéréotypes du cinéma de genre ? Une vie peut-elle trouver son apaisement quand on tente de se fondre dans le moule de la fiction ? Voilà les questions que soulève Pierre Ahnne dans ce quatrième roman troublant. Et il en entraîne bien d’autres au passage, comme une voiture qui file à toute allure sur une départementale déserte, en plein cœur de l’hiver.
Pierre Ahnne, Couple avec pistolet dans un paysage d’hiver, Denoël, 2005, 140 pp.
10:35 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
25/07/2005
Attention, chef d'oeuvre!
 Tout le monde n’a pas la chance de commencer sa carrière d’écrivain avec un roman pareil. « Les frère Y » est le genre de bouquin qu’on avale sans mâcher, fasciné par l’univers dès les premières lignes, amusé par le ton léger, l’écriture fluide et le sujet poignant. Nous sommes au milieu du dix-neuvième siècle, en Italie, une femmes donne naissance à un « monstre » un enfant à deux têtes, deux troncs, quatre bras mais un seul corps. Et trois fesses, pour compliquer les choses. Un Y, en résumé, pour les rendre simples et claires à tous.
Tout le monde n’a pas la chance de commencer sa carrière d’écrivain avec un roman pareil. « Les frère Y » est le genre de bouquin qu’on avale sans mâcher, fasciné par l’univers dès les premières lignes, amusé par le ton léger, l’écriture fluide et le sujet poignant. Nous sommes au milieu du dix-neuvième siècle, en Italie, une femmes donne naissance à un « monstre » un enfant à deux têtes, deux troncs, quatre bras mais un seul corps. Et trois fesses, pour compliquer les choses. Un Y, en résumé, pour les rendre simples et claires à tous.
Le livre ne nous racontera rien d’autre que la vie de ces frères siamois, le parcours extraordinaire qui les fera passer entre les mains des charlatans et des médecins, sur les chemins de l’Italie et dans les villes les plus prestigieuses de l’Amérique, pour revenir, comme Voltaire, cultiver leur jardin dans les environs de Venise.
Bien sûr, on nous parle d’une époque révolue, d’un monde de foires et d’expositions qui n’ont plus grand chose à voir avec les nôtres. Et pourtant, à travers le portrait de ces « aberrations de la nature », ce sont des préoccupations toutes contemporaines que l’auteur nous fourre dans la tête : le cabinet des horreurs du docteur Spitzner est-il vraiment différent du défilé de malades chroniques proposé par Jean-Luc Delarue dans ses émissions de télé-poubelle? La fascination du public pour les enfants-troncs, les femmes à barbe et les hommes-singes n’est elle pas la même que celle de l’audimat d’aujourd’hui pour les TOC, les abouliques, les névrosés de toutes sortes, repoussoirs et exutoires de notre normalité déprimante, de notre banalité épuisante ou de nos travers inquiétants ?
On ne peut que recommander la lecture de ce premier roman exceptionnel, particulièrement à ceux qui ont aimé « Freaks » ou « Elephant Man » au cinéma, à ceux qui traînent dans les musées de sciences naturelles à la recherche des bocaux de formol et des tables de dissection. Mais il ravira aussi tous ceux qui aiment que la lecture les plongent loin de leur quotidien, dans la campagne italienne du dix-neuvième, sur le pont des transatlantiques et les baraques de foire de l’Europe entière. Les personnages sont hauts en couleur, les scènes visuelles, on s’amuse comme au cinéma, c'est divertissant et érudit, malin et tendre à la fois. On tourne les pages sans compter. Pour un premier essai dans l’écriture de fiction, Marie-Eve Stenuit réussit un chef d’œuvre !
Marie-Eve Sténuit, Les frères Y, Le Castor astral, 2005.
13:30 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
18/07/2005
Naissance d'un gourou de Kitano
 Kazuo est dans une mauvaise passe : il vient de se faire larguer, il n’a plus de boulot, et, comme ses repères ont été brouillés, il se pose des tas de questions sur le sens de l’existence et sur le rôle de dieu dans le fonctionnement de l’univers. Pourquoi est-il là et à quoi peut-il bien servir ? On pourrait dire que c’est le hasard le plus pur qui lui fait croiser coup sur coup un prospectus publicitaire pour une secte et la séance de prosélytisme d’une toute jeune religion, dans un parc public. Mais il n’en est rien, on s’en doute ; dans d’autres circonstances, le jeune Kazuo aurait poursuivi son chemin, la main serrée contre celle de sa fiancée, il serait retourné au bureau… Le voici qui s’arrête et assiste, en direct à la guérison d’une paralytique par un gourou barbu, dont les mains font des étincelles bleues et des miracles. En quelques minutes, Kazuo a rejoint le groupe des adorateurs. Il entre en religion sans trop savoir ni pourquoi ni comment et, poussé par le désir de saisir le sens des choses qui le dépassent, il va petit à petit prendre une place de choix parmi les fidèles. Mais le petit monde de la secte est loin d’être un univers de sainteté : les permanents qui entourent le gourou se saoulent au whisky ou à la bière, dépensent les dons dans des salons de massage, fréquentent de fort près certaines fidèles en perte de repères. Kazuo, sorte de Candide japonais au pays des illuminés, découvrira petit à petit les rouages qui font tourner la grande horlogerie religieuse et apprendra à ses dépens que les mystères de la foi s’expliquent bien souvent par les rapports de force entre les hommes qui les édictent. Cela ne l’empêchera pas d’occuper bientôt au sein du groupe une place unique et… inquiétante.
Kazuo est dans une mauvaise passe : il vient de se faire larguer, il n’a plus de boulot, et, comme ses repères ont été brouillés, il se pose des tas de questions sur le sens de l’existence et sur le rôle de dieu dans le fonctionnement de l’univers. Pourquoi est-il là et à quoi peut-il bien servir ? On pourrait dire que c’est le hasard le plus pur qui lui fait croiser coup sur coup un prospectus publicitaire pour une secte et la séance de prosélytisme d’une toute jeune religion, dans un parc public. Mais il n’en est rien, on s’en doute ; dans d’autres circonstances, le jeune Kazuo aurait poursuivi son chemin, la main serrée contre celle de sa fiancée, il serait retourné au bureau… Le voici qui s’arrête et assiste, en direct à la guérison d’une paralytique par un gourou barbu, dont les mains font des étincelles bleues et des miracles. En quelques minutes, Kazuo a rejoint le groupe des adorateurs. Il entre en religion sans trop savoir ni pourquoi ni comment et, poussé par le désir de saisir le sens des choses qui le dépassent, il va petit à petit prendre une place de choix parmi les fidèles. Mais le petit monde de la secte est loin d’être un univers de sainteté : les permanents qui entourent le gourou se saoulent au whisky ou à la bière, dépensent les dons dans des salons de massage, fréquentent de fort près certaines fidèles en perte de repères. Kazuo, sorte de Candide japonais au pays des illuminés, découvrira petit à petit les rouages qui font tourner la grande horlogerie religieuse et apprendra à ses dépens que les mystères de la foi s’expliquent bien souvent par les rapports de force entre les hommes qui les édictent. Cela ne l’empêchera pas d’occuper bientôt au sein du groupe une place unique et… inquiétante.
Takeshi Kitano a plus d’une corde à son arc : vedette des médias japonais, réalisateur de cinéma, il utilise ici le roman pour mettre en lumière la grande escroquerie des nouvelles religions, de ces groupes aux leaders charismatiques et aux adeptes naïfs, qui se lancent sur le marché de la foi à coup de marketing, de bluff et de prestidigitation. Le bouquin se dévore sans faim, les pages se tournent d’elles-mêmes tant on s’amuse à suivre cette équipe de religieux tout aussi déséquilibrés et égocentriques les uns que les autres. Le talent de l’auteur consiste à garder constamment intacte l’interrogation du lecteur : tout cela n’est-il qu’une fumisterie ou l’esprit et la foi ont-ils vraiment le pouvoir de changer les choses, de transformer les êtres ? La réponse finale de Kitano n’est certainement pas aussi claire qu’on l’attendrait. Car, si la présence de dieu ne peut être démontrée, son effet sur les hommes, lui, est indubitable. Pour le bien ou pour le mal ? A vous de lire…
Takeshi Kitano, Naissance d'un gourou, Denoël, 2005, 226 pp.
10:05 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
14/07/2005
Lui aussi, il peut voyager au bout du monde
Le récit de voyage est un genre littéraire presque aussi vieux que le monde, si pas plus, peut-être, et  qui a encore de beaux jours devant lui. Avec « Gringoland », Julien Blanc-Gras, qui n’aura trente ans que l’an prochain, signe un premier roman en forme de récit de voyage au goût du jour. Valentin, le jeune héros, décide sur un coup de tête, suite à la mort de sa chienne et la défonce de son téléviseur dans un accès de rage, de mettre les voiles pour de bon, de s’acheter un billet d’avion pour l’Amérique centrale. Pour le Mexique, plus précisément. Histoire d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, si les moutons qui la broutent et les barbus qui la fument ont d’autres leçons à donner que les bouffons qu’on voit à la télévision. Valentin manque de repère, aime la musique, joue de la guitare, parle espagnol et anglais, adore voyager, mais n’a pas la moindre idée de ce qui l’attend et de ce qu’il doit chercher. Il part le sac au dos et la guitare en bandoulière comme on se suicide, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce qu’il y avait avant. En d’autres mots, pour claquer la porte au nez de la société de surconsommation, de distractions formatées, de ronron boulot, marmots, dodo. Il s’envole pour voir la réalité de près. Et il sera servi, le Valentin. Car sa route croisera celle de tous les paumés de la planète ou presque, les toxicomanes embourbés dans les hallucinogènes, les néos-babas obnubilés par la nature et les merveilles de l’univers, les natifs du coin, édentés, sans ressources, mais guère plus épanouis que les autres. Le voyage de Valentin, qui traversera le Mexique, les temples et le désert, les Etats-Unis en bus, jusqu’à Hollywood et ses apparences écœurantes, le Belize puis Cuba, ne lui fera rencontrer que des êtres tronqués, repliés, frustrés, asservi, aliénés. Sur des milliers de visages, quelques sourires à peine appartiennent à des humains épanouis. Et encore, la mort est toujours à deux pas, prête à leur tomber dessus comme un fruit mûr chute de l’arbre.
qui a encore de beaux jours devant lui. Avec « Gringoland », Julien Blanc-Gras, qui n’aura trente ans que l’an prochain, signe un premier roman en forme de récit de voyage au goût du jour. Valentin, le jeune héros, décide sur un coup de tête, suite à la mort de sa chienne et la défonce de son téléviseur dans un accès de rage, de mettre les voiles pour de bon, de s’acheter un billet d’avion pour l’Amérique centrale. Pour le Mexique, plus précisément. Histoire d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs, si les moutons qui la broutent et les barbus qui la fument ont d’autres leçons à donner que les bouffons qu’on voit à la télévision. Valentin manque de repère, aime la musique, joue de la guitare, parle espagnol et anglais, adore voyager, mais n’a pas la moindre idée de ce qui l’attend et de ce qu’il doit chercher. Il part le sac au dos et la guitare en bandoulière comme on se suicide, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce qu’il y avait avant. En d’autres mots, pour claquer la porte au nez de la société de surconsommation, de distractions formatées, de ronron boulot, marmots, dodo. Il s’envole pour voir la réalité de près. Et il sera servi, le Valentin. Car sa route croisera celle de tous les paumés de la planète ou presque, les toxicomanes embourbés dans les hallucinogènes, les néos-babas obnubilés par la nature et les merveilles de l’univers, les natifs du coin, édentés, sans ressources, mais guère plus épanouis que les autres. Le voyage de Valentin, qui traversera le Mexique, les temples et le désert, les Etats-Unis en bus, jusqu’à Hollywood et ses apparences écœurantes, le Belize puis Cuba, ne lui fera rencontrer que des êtres tronqués, repliés, frustrés, asservi, aliénés. Sur des milliers de visages, quelques sourires à peine appartiennent à des humains épanouis. Et encore, la mort est toujours à deux pas, prête à leur tomber dessus comme un fruit mûr chute de l’arbre.
On pourrait croire que « Gringoland » est un roman désabusé misant tout sur le désenchantement du monde. Il n’en est rien ; c’est un récit léger, rapide, bourré de cynisme et de lucidité crasse, nourri de mauvaise foi et d’autodérision. Car ce qui frappe le plus dès le début du voyage, c’est à quel point le héros s’inclut dans le monde qu’il dénigre. Si l’humanité et aussi dérisoire que risible, lui-même en fait partie et ne vaut guère mieux que le reste. Tout aussi lâche, tout aussi inabouti que les autres qu’il croise. Son seul mérite, au fond, est d’oser l’avouer et de permettre, ainsi, aux lecteurs de se poser à leur tour ces questions sans réponse. Et, comme l’auteur, de les esquisser avec un sourire amusé.
Julien Blanc-Gras, Gringoland, roman, Au Diable Vauvert, 2005
15:30 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer

















