13/11/2008
Spirou remonte aux sources du Z dans Bain à Bulles

Pour ce cinquantième tome des aventures de Spirou et Fantasio, le tandem est rejoint par Yann en renfort scénaristique. Deux poids lourds du scénario pour un héros de légende, voilà qui augurait du meilleur.
Et, en effet, « Aux sources du Z » ne manque pas d'ambition : on y retrouve Zorglub et le comte de Champignac au chevet de Miss Flanner, à l'article de la mort. Ils l'ont tous deux aimée dans leur jeune temps, avant que Zorglub ne se laisse tenter par le côt osbcur de la Zorglonde. Pour sauver la belle de cœur de ces deux messieurs, Spirou est contraint de remonter dans le temps grâce à des sauts de puce, passant d'une époque à l'autre et revenant, l'espace de quelques cases, dans l'univers de certains albums mythiques de la série : « La mauvaise tête », « Le dictateur et le champignon »... (lire la suite sur Bain à Bulles, ma chronique BD sur Bibliobs)
15:06 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bd, morvan, munuera, bibliobs, bain à bulles, spirou, zorglub |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
10/11/2008
Anouk Ricard - Commissaire Toumi
 Les éditions Sarbacane annoncent avec plaisir l'entrée d'Anouk Ricard dans le monde de la bande dessinée adulte, grâce au premier tome des enquêtes du Commissaire Toumi, un album à la couverture très noire et au titre révélateur « Le crime était presque pas fait. »
Les éditions Sarbacane annoncent avec plaisir l'entrée d'Anouk Ricard dans le monde de la bande dessinée adulte, grâce au premier tome des enquêtes du Commissaire Toumi, un album à la couverture très noire et au titre révélateur « Le crime était presque pas fait. »
Présenté comme un « mélange détonant entre langage cru, graphisme naïf et ambiance gore », ce livre propose quatre enquêtes parodiques menées par l'improbable duo Toumi (un bouledogue commissaire célibataire, qui fume sans cesse, est sujet aux cauchemars et gribouille pendant ses conversation téléphoniques) et Stucky (un chat tigré bête comme un boîte de Kitekat pas ouverte mais doté d'un humour à deux balles – « ...de ping pong. ha! ha! », ajouterait-il sans doute pour bien faire comprendre de quel registre son humour relève). Les deux sont confrontés à de mystérieux crimes à élucider, dans la plus pure tradition du whodunnit à l'anglaise. On trouve la cadavre (un ver coupé en rondelles, une jeune fille étranglée avec sa propre écharpe...), on inspecte la scène du méfait, on interroge les témoins puis, après une nuit de réflexion, on convoque les suspects pour une ultime scène de confrontation, de révélations et d'aveux. Une structure extrêmement classique qui rappelle aussi bien les enquêtes de Miss Marple ou d'Hercule Poirot que les parodies décalées de l'inspecteur Chabrol et son adjoint Bougret, signées Marcel Gotlib dans ses meilleures années de délire. Anouk Ricard situe son projet à mi-chemin entre les deux, avec un très léger décalage, instillé notamment par les protagonistes qu'elle choisit (un ver de terre critique d'art, des oiseaux millionnaires ou un écureuil fan de musique ringarde des années 80) mais une fidélité inébranlable au déroulement logique et temporel de l'histoire. Elle ne cherche pas comme Gotlib à démontrer le crime par l'absurde et à détourner le récit d'énigme, elle le démonte plutôt, le simplifie jusqu'à son plus simple appareil et démontre ainsi, une fois de plus, qu'elle a un sens inné du récit épuré, qui fait merveille sur les plus jeunes.
Car, il faut bien que je l'avoue (puisque il est question d'aveu, autant commencer par le mien), ma fille de sept ans, inconditionnelle d'Anouk Ricard (elle a reconnu au premier coup d'œil le trait familier des deux tomes d'Ana et Froga qu'elle a lus et relus des dizaines de fois), m'a piqué l'album et l'a achevé avant moi. (lire la suite dans Bain à Bulles sur Bibliobs)
21:48 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anouk ricard, toumi, sarbacane, bd, littérature, polar, enquête |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
26/10/2008
Le blog d'Henri Michaux
 Des questions idiotes, il m'en passe beaucoup par la tête. Celle-ci, par exemple : qu'est-ce qu'Henri Michaux aurait bien pu publier sur son blog ?
Des questions idiotes, il m'en passe beaucoup par la tête. Celle-ci, par exemple : qu'est-ce qu'Henri Michaux aurait bien pu publier sur son blog ?
Bien entendu, les érudits et les pisse-froid me répondront que Michaux n'aurait jamais tenu de blog, lui qui ne voulait déjà pas que ses textes soient publiés au format poche et qui résistait, des quatre fers, pour que son œuvre ne soit pas accessible au plus grand nombre. Avec une posture pareille, on n'achète pas une Livebox ou Asus EEE pour bloguer sans interruption.
Encore moins un Iphone.
Pas même un vieux PC avec une connexion par modem téléphonique.
C'est sans doute vrai.
Mais comme Michaux l'écrivit très justement, même si c'est vrai, c'est faux.
Parce qu'il ne faut pas imagine le vieux Michaux, reclus et replié, quasi ermite, celui qui refuse de se faire photographier ou interviewer entrer dans une boutique de téléphonie ou un Apple Store, mais le tout jeune Henri, celui qui n'a pas encore traversé l'Atlantique, mieux encore, celui qui n'a pas quitté la Belgique. Après être passé à la Fnac, une fois branché son routeur sans fil et allumé son iBook, ne se sentirait-il pas autorisé à écrire et publier, d'où qu'il soit ? Internet et un blog gratuit ne suffiraient-ils pas comme tribune pour son imaginaire sans limite ou presque ?
Mettons que cette hypothèse tienne ; on en revient alors à la question du début : que publierait-il ?
- La nuit, je ne remue pas ? (essai sur le chat et les mondes virtuels)
- Un certain Clavier ? (les aventures poétiques d'un pauvre type perdu dans un monde qui lui échappe)
- Connaissance par les gaufres ? (une spécialité culinaire belge qui vaut bien la mescaline pour qui n'a pas beaucoup voyagé)
- Epreuves, exorcismes ? (son compte-rendu des soirées de week-end sur les télés du monde entier)
Oh, et puis non, une fois connecté à l'Internet, Michaux ferait sans doute comme des tas de types mal sociabilisé, il téléchargerait des films X, se ferait passer pour une gothique sur IMVU et se défoulerait en lâchant des commentaires poujadistes au bas des articles des grands quotidiens. Il perdrait ses plus belles heures à visiter des blogs au lieu d'écrire. Comme tout le monde ou presque. Comme vous, comme moi, par exemple.
Au fond, je me dis qu'Henri Michaux a bien fait de naître en son temps, de se barrer d'où il était né, de se replier, de s'exiler de tout, y-compris de lui-même, de ne pas tenir de blog, de ne pas afficher sa photo sur Facebook, de ne pas répondre à ses mails.
Allez, je vais éteindre mon ordi et me replonger dans Ailleurs ou dans Ecuador, je ne le regretterai pas.
21:03 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : michaux, iphone, asus eee, poésie, henri michaux, plume, littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
09/10/2007
Plongez dans mon blog à bulles
 Depuis quelques semaine, je collabore au nouveau site web que le Nouvel Obs consacre à la littérature. J'ai le plaisir d'y publier des notes de lecture sur les bandes dessinées qui me tombent sous la main (celles qui me tombent des mains, je n'en parle pas, ou pas en bien, en tout cas). Ca a la forme d'un blog et ça s'appelle "Bain à bulles" pour qu'on s'y sente bien. Si vous passez par là, revenez-donc ici me dire ce que vous en pensez ;-) Et si vous avez lu d'excellentes BD, n'hésitez pas à me le faire savoir, on n'a jamais assez d'yeux pour tout lire.
Depuis quelques semaine, je collabore au nouveau site web que le Nouvel Obs consacre à la littérature. J'ai le plaisir d'y publier des notes de lecture sur les bandes dessinées qui me tombent sous la main (celles qui me tombent des mains, je n'en parle pas, ou pas en bien, en tout cas). Ca a la forme d'un blog et ça s'appelle "Bain à bulles" pour qu'on s'y sente bien. Si vous passez par là, revenez-donc ici me dire ce que vous en pensez ;-) Et si vous avez lu d'excellentes BD, n'hésitez pas à me le faire savoir, on n'a jamais assez d'yeux pour tout lire.
15:49 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : BD, bibliobs |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
19/02/2007
Le Sergent Laterreur est de retour
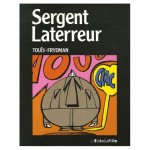 Le Sergent Laterreur fit les beaux jours du journal Pilote dans les années septante. Ce salopard professionnel, spécialiste de l’ordre hurlé à l’oreille du soldat, de la corvée patate, de la semaine au cachot et des ronds de jambe devant l’état major est à lui seul une parodie intégrale du système hiérarchique militaire. On crie sur tout ce qui est inférieur, on sanctionne, on punit, on ridiculise, on agit sans réfléchir, suivant les ordres sans faiblir puis on médaille les survivants quand la boucherie laisse quelques rescapés en vie. Sur un thème très en vogue à l’époque du «Peace and Love», le duo Touïs et Frydman est parvenu à créer une série de gags en deux planches qui défient le temps : leur trait géométrique, leur travail en relief sur le dessin stylisé, leur mise en couleur par à-plats très tranchés, leurs bulles envahies par le texte hurlé et taillé en trois dimensions et leur galerie de personnages croqués au lance-flamme ont traversé le temps sans vieillir le moins du monde. Au contraire, une fois mise à distance de l’effet de mode anti-guerrier, la série démontre ses qualités formidables : une abstraction quasi allégorique qui permet au lecteur de rentrer sans effort dans cet univers où l’on ne peut être que maître ou esclave, assaillant ou assailli, où l’on défile ou regarde défiler, où l’on s’exécute sans broncher puis l’on file au trou sans détour au boutr du compte quoi que l'on ait fait, puisque l'on est simple troufion et qu'on ne mérite pas mieux.
Le Sergent Laterreur fit les beaux jours du journal Pilote dans les années septante. Ce salopard professionnel, spécialiste de l’ordre hurlé à l’oreille du soldat, de la corvée patate, de la semaine au cachot et des ronds de jambe devant l’état major est à lui seul une parodie intégrale du système hiérarchique militaire. On crie sur tout ce qui est inférieur, on sanctionne, on punit, on ridiculise, on agit sans réfléchir, suivant les ordres sans faiblir puis on médaille les survivants quand la boucherie laisse quelques rescapés en vie. Sur un thème très en vogue à l’époque du «Peace and Love», le duo Touïs et Frydman est parvenu à créer une série de gags en deux planches qui défient le temps : leur trait géométrique, leur travail en relief sur le dessin stylisé, leur mise en couleur par à-plats très tranchés, leurs bulles envahies par le texte hurlé et taillé en trois dimensions et leur galerie de personnages croqués au lance-flamme ont traversé le temps sans vieillir le moins du monde. Au contraire, une fois mise à distance de l’effet de mode anti-guerrier, la série démontre ses qualités formidables : une abstraction quasi allégorique qui permet au lecteur de rentrer sans effort dans cet univers où l’on ne peut être que maître ou esclave, assaillant ou assailli, où l’on défile ou regarde défiler, où l’on s’exécute sans broncher puis l’on file au trou sans détour au boutr du compte quoi que l'on ait fait, puisque l'on est simple troufion et qu'on ne mérite pas mieux.
C’est jubilatoire, délirant, complètement débridé et c’est réédité en intégrale par l’Association dans un épais volume qui démontre, si c’était nécessaire, qu’on peut tenir trois ans avec un seul principe de gags sans dévier de sa ligne initiale et sans démériter.
Après ça, les auteurs ont disparu pour de bon. Malheureusement pour nous, car à relire ce volume, on en reprendrait bien quelques planches !
09:39 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : litterature, BD |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
09/01/2007
Pourquoi il faut lire Pierre
 On ne sort jamais indemne d’un grand livre. La dernière page tournée, on continue à flotter entre deux eaux, le corps ankylosé, l’esprit vagabond, la pensée errant dans les terres indéfinies qui séparent la fiction, d’où l’on sort avec peine, du monde rée,l où l’on n’a aucune envie de rentrer. Un grand livre, ça peut être un roman, ça peut être un essai, ça peut aussi être une bande dessinée. Comme celle que nous proposent Olivier Ka et Alfred, par exemple, sous le titre étonnant de «Pourquoi j’ai tué Pierre». Ce sont les éditions Delcourt qui ont publié à l’automne ce livre d’une profondeur étonnante. On est ravi de le savoir sélectionné pour le Grand Prix d’Angoulême. Et on espère qu’il continuera à rencontrer demain le plus de lecteurs possible, car, il faut bien l’avouer, cet album est un véritable chef d’œuvre, qui laisse le lecteur sans voix.
On ne sort jamais indemne d’un grand livre. La dernière page tournée, on continue à flotter entre deux eaux, le corps ankylosé, l’esprit vagabond, la pensée errant dans les terres indéfinies qui séparent la fiction, d’où l’on sort avec peine, du monde rée,l où l’on n’a aucune envie de rentrer. Un grand livre, ça peut être un roman, ça peut être un essai, ça peut aussi être une bande dessinée. Comme celle que nous proposent Olivier Ka et Alfred, par exemple, sous le titre étonnant de «Pourquoi j’ai tué Pierre». Ce sont les éditions Delcourt qui ont publié à l’automne ce livre d’une profondeur étonnante. On est ravi de le savoir sélectionné pour le Grand Prix d’Angoulême. Et on espère qu’il continuera à rencontrer demain le plus de lecteurs possible, car, il faut bien l’avouer, cet album est un véritable chef d’œuvre, qui laisse le lecteur sans voix. Comment, en effet, en parler sans dévoiler l’essence même du livre, à savoir cette formidable narration qui prend le lecteur par la main pour le mener des replis confortables de l’enfance insouciante vers les tréfonds de la culpabilité et de la salissure ? Olivier est un gamin comme il y en a tant, au cœur des années septante. Son père fait de la BD au mensuel Hara-Kiri, sa mère écrit des romans pour la jeunesse. Leur maison, à la campagne pas très loin de Paris, accueille tous les amis de passage et, parmi ceux-ci, un certain Pierre, curé de gauche, rondouillard et jovial, barbu, hirsute, pareil à Barbouille le Barbapapa poilu. C’est lui qui emmènera le petit Olivier en colonie de vacances. Lui, l’adulte en qui le gamin a toute confiance, l’ami des parents, le copain sympa qui se confie et qui témoigne envers le gamin une amitié sans borne. Une amitié ou autre chose ? C’est bien là que se situe la limite floue et trouble entre sympathie débordante et… abus de confiance. Il n’y aura pas que des confidences entre l’adulte et le garçon, il y aura aussi des attouchements : des gestes sales, qui blessent au plus profond. Et que Pierre cherchera à dissimuler sous le sceau du secret.
Il faudra des années à Olivier, devenu romancier et scénariste, pour qu’il imagine de mettre des mots sur cette histoire, pour qu’il prenne cette matière intime et la transforme en récit dessiné. Et le résultat est époustouflant.
Rarement la bande dessinée atteint-elle une telle perfection de forme et de fonds, les images répondant de manière troublante aux événements racontés. Le dessin d’abord joyeux et naïf se brouille par moment, les cases se décomposent ; le dessinateur à certains moments laisse simplement parler la photo, les images caméra, pour montrer les lieux tels qu’ils sont aujourd’hui, avant de réinterpréter dans une tempête graphique, les paysages de campagne torturés par les reliefs des paysages intérieurs du narrateur. Il fallait un talent fou pour réussir un projet aussi risqué que celui-là. Olivier Ka et Alfred n’en ont pas manqué, au contraire : ils ont tout misé sur la transparence parfaite, la plus simple autobiographie, soulignée par la mise en scène des auteurs eux-mêmes, en route pour enquêter sur leur sujet dans la campagne française. Au-delà de la culpabilité, de la responsabilité des adultes vis-à-vis des enfants, cet album magistral traite aussi du temps qui passe : du passage à l’âge adulte puis à la vieillesse et des poids morts que l’on ne peut lâcher au franchir des étapes.
Le sujet est dur. On sent que le pire va arriver. On le redoute. On le voit venir. On en est témoin. On voudrait que ça ne se passe pas. On en veut à Pierre. On en veut au monde. A cause de cette grosse pierre qu’on a dans la gorge. On lit avec appréhension mais on ne peut pas s’empêcher de tourner les pages. Puis on est envahi par l’émotion, comme un ruisseau qui déborde après l’orage. C’est beau. C’est terriblement beau. Parce que c’est plus qu’une bonne BD, c’est carrément un chef d’œuvre.
Olivier Ka et Alfred, «Pourquoi j’ai tué Pierre», Delcourt, collection Mirages.
17:13 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (3) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
23/04/2006
Benoît Labaye nous a quittés
Je viens d'apprendre à l'instant le décès de Benoît Labaye, tout jeune romancier belge, puisqu'il ne publiait que depuis deux ans. Difficile de mettre des mots sur le départ de quelqu'un qui en laisse derrière lui. Mieux vaut désormais le lire que le commenter, et pour vous inciter à découvrir ses deux premiers livres, en attendant la publication posthume du troisième, voici les notes que j'avais rédigées après la lecture des deux romans.
Les mots contre les mauxLa littérature peut parfois aider à vivre, si par vivre on entend le fait de percevoir le monde tel qu’il est vraiment, avec ses limites, ses faiblesses, et qu’on accepte qu’à défaut de la changer de fond en comble, on peut simplement le rendre plus humain, plus accueillant. Un roman, paru ces derniers mois traite justement du rapport qu’on peut entretenir avec la maladie.(...)
 Avec « Vous ne dites rien », Benoît Labaye se lance dans la littérature de fiction. Ce Liégeois pratiquait l’écriture depuis de nombreuses années, en amateur, et on attendait avec impatience le premier roman qu’un éditeur accepterait de proposer au public. C’est à présent chose faite et ce petit livre bleu, publié dans la jolie collection « Luciole » des Editions Luce Wilquin, valait la peine de patienter. Ici, c’est la maladie qui est au centre du récit. Un homme sans identité connue est accueilli dans un hôpital de la région liégeoise, on l’a trouvé presque congelé en plein hiver au cœur des Fagnes, dans un lieu isolé où, normalement, nul n’aurait dû lui porter secours. Qu’est-ce qui a bien pu pousser cet homme à choisir une fin pareille ? Et pourquoi ce mystérieux personnage ne parle-t-il pas, maintenant qu’il a recouvré un semblant de santé ? Ce sont ces questions et bien d’autres qui vont tarauder une infirmière plus compatissante que les autres. Une relation aussi étrange qu’intense va se nouer entre les deux personnages. On débouche ainsi sur de nouvelles interrogations : quelles sont les limites de l’amour ? Peut-on aimer un homme dont on ne peut rien obtenir ? N’est-on pas déjà mort quand on a voulu en finir pour de bon ? Et quelle force pourrait alors nous ramener à la vie ? L’espoir, simplement ? N’est-ce pas un peu court ? Benoît Labaye tient là un sujet poignant, sur lequel il ne s’appesantit jamais, au contraire. La construction de son récit, en petits chapitres successifs, dévoile progressivement les fils qui tendent ses personnages, les fils dont ils sont tissés et qui les rendent à la fois si fragiles et si forts. Il n’est jamais question de donner des réponses toutes faites. Le pouvoir de suggestion du roman, la force d’évocation de ces destins déchirés, de ces vies qui se croisent, entraînent le lecteur sur des chemins où il devra, seul, trouver des bribes de réponses, ou plus simplement, accepter que ses certitudes soient ébranlées. C’est là, sans doute, l’une des forces de la fiction : offrir à ceux qui s’y plongent un monde aussi complexe que celui dans lequel nous vivons, aussi dense, aussi riche, mais dépouillé des certitudes qui nous rassurent. Et la leçon que porte ces deux textes est fort proche : par-delà la maladie, ce sont des êtres humains qui souffrent et qui aiment. Rien ne sert de les juger ou de les sanctionner, il faut simplement aller à leur rencontre et les laisser venir à la nôtre, par-delà les stéréotypes. En lisant ces deux romans, on ne doute pas un instant que c’est une démarche salutaire.
Avec « Vous ne dites rien », Benoît Labaye se lance dans la littérature de fiction. Ce Liégeois pratiquait l’écriture depuis de nombreuses années, en amateur, et on attendait avec impatience le premier roman qu’un éditeur accepterait de proposer au public. C’est à présent chose faite et ce petit livre bleu, publié dans la jolie collection « Luciole » des Editions Luce Wilquin, valait la peine de patienter. Ici, c’est la maladie qui est au centre du récit. Un homme sans identité connue est accueilli dans un hôpital de la région liégeoise, on l’a trouvé presque congelé en plein hiver au cœur des Fagnes, dans un lieu isolé où, normalement, nul n’aurait dû lui porter secours. Qu’est-ce qui a bien pu pousser cet homme à choisir une fin pareille ? Et pourquoi ce mystérieux personnage ne parle-t-il pas, maintenant qu’il a recouvré un semblant de santé ? Ce sont ces questions et bien d’autres qui vont tarauder une infirmière plus compatissante que les autres. Une relation aussi étrange qu’intense va se nouer entre les deux personnages. On débouche ainsi sur de nouvelles interrogations : quelles sont les limites de l’amour ? Peut-on aimer un homme dont on ne peut rien obtenir ? N’est-on pas déjà mort quand on a voulu en finir pour de bon ? Et quelle force pourrait alors nous ramener à la vie ? L’espoir, simplement ? N’est-ce pas un peu court ? Benoît Labaye tient là un sujet poignant, sur lequel il ne s’appesantit jamais, au contraire. La construction de son récit, en petits chapitres successifs, dévoile progressivement les fils qui tendent ses personnages, les fils dont ils sont tissés et qui les rendent à la fois si fragiles et si forts. Il n’est jamais question de donner des réponses toutes faites. Le pouvoir de suggestion du roman, la force d’évocation de ces destins déchirés, de ces vies qui se croisent, entraînent le lecteur sur des chemins où il devra, seul, trouver des bribes de réponses, ou plus simplement, accepter que ses certitudes soient ébranlées. C’est là, sans doute, l’une des forces de la fiction : offrir à ceux qui s’y plongent un monde aussi complexe que celui dans lequel nous vivons, aussi dense, aussi riche, mais dépouillé des certitudes qui nous rassurent. Et la leçon que porte ces deux textes est fort proche : par-delà la maladie, ce sont des êtres humains qui souffrent et qui aiment. Rien ne sert de les juger ou de les sanctionner, il faut simplement aller à leur rencontre et les laisser venir à la nôtre, par-delà les stéréotypes. En lisant ces deux romans, on ne doute pas un instant que c’est une démarche salutaire.
Benoît Labaye, « Vous ne dites rien », Luce Wilquin collection Luciole.
Terre lointaine
 C’est au fond la question de la résignation qui est au centre du deuxième roman de Benoît Labaye. Alors que son héros se rend en Australie avec une femme qu’il aime, dans l’espoir d’y construire une nouvelle vie, voilà qu’il atterrit dans un lieu étrange, sorte d’hôtel de luxe en bordure d’une plage de sable blanc. Il s’y retrouve coincé en compagnie d’une série de personnages aux caractères bien différents, qui tous sont préoccupés par l’envie de quitter ce lieu mais semblent rendus immobiles par une force irrépressible. De jour en jour, ce qui semble n’être qu’une étape dans un voyage appelé à se poursuivre se transforme en une sorte de piège dont il est impossible de s’échapper.
C’est au fond la question de la résignation qui est au centre du deuxième roman de Benoît Labaye. Alors que son héros se rend en Australie avec une femme qu’il aime, dans l’espoir d’y construire une nouvelle vie, voilà qu’il atterrit dans un lieu étrange, sorte d’hôtel de luxe en bordure d’une plage de sable blanc. Il s’y retrouve coincé en compagnie d’une série de personnages aux caractères bien différents, qui tous sont préoccupés par l’envie de quitter ce lieu mais semblent rendus immobiles par une force irrépressible. De jour en jour, ce qui semble n’être qu’une étape dans un voyage appelé à se poursuivre se transforme en une sorte de piège dont il est impossible de s’échapper.
On pense au village du Prisonnier, dont on aurait retiré tout système hiérarchique, ou à l’univers oppressant de Cube, dont il est impossible de se détacher sans en comprendre la nature profonde. Sont-ils au purgatoire, dans l’attente d’un jugement dernier ou, à tout le moins, d’un jugement tout court ? Sont-ils coincés à tout jamais ? Benoît Labaye touche avec « Australie » à un sujet poignant, presque métaphysique. L’arrachement aux êtres aimés, la solitude terrible dans laquelle se trouvent plongés les personnages pour répondre aux questions insolubles, ce sont autant de matériaux puissants qui donnent au roman une profondeur certaine. Mais on regrette que la surface ne soit pas à la hauteur de cette ambition. Les personnages manquent de relief, on les sent trop éthérés, diaphanes, alors qu’on souhaiteraient qu’ils soient concrets et quotidiens, hauts en couleur et riches en rebondissements. Et leur errance un peu terne et fade ne fait rien pour soulager le besoin du lecteur de sentir quelque chose qui vibre, un drame qui se noue, un enjeu qui se trame. Il faudra attendre l’évasion finale pour que la tension monte un peu, mais ce n’est pas assez. On sort du roman comme on s’échappe de cet hôtel immaculé au bord de la plage, avec une grande envie d’oxygène et d’action, avec l’impression qu’il ne s’est au fond rien passé pendant tout ce temps. Dommage, car grâce à la lecture du roman précédent de Benoît Labaye, on est bien convaincu qu’il est capable de donner corps à des personnages et de nous faire vibrer avec leur moindre souffle. On attend donc l’ouvrage suivant pour retrouver ce plaisir.
Benoît Labaye, « Australie », Editions Luce Wilquin. http://www.wilquin.com
20:55 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
26/01/2006
Du Parrondo brillant sur papier mat
 « Ni plus ni moins », le dernier album de José Parrondo est tout simplement envoûtant. Vu de l’extérieur, il peut sembler anodin, avec sa couverture qui représente un gros nuage blanc, sur fond de ciel bleu, où deux bonshommes sans bras semblent scruter le plancher des vaches. Le trait naïf, l’écriture cursive, les à-plats de couleurs vives, tout cela doit sembler bien enfantin à la plupart des lecteurs. Et un coup d’œil rapide à l’intérieur du livre confortera sans doute cette impression. 46 planches de trois fois trois cases chacune, avec le même trait, les mêmes couleurs vives et les mêmes bonshommes, voilà qui ne semble guère passionnant. Eh bien, détrompez-vous, c’est exactement le contraire. Les 414 cases de l’album suivent les péripéties rocambolesques d’un bonhomme de neige, d’une bande de fourmis, d’un somnambule, d’un oiseau ou d’une camionnette de shampooing, dans un enchaînement hallucinant, qui semble réinventer les principes de la causalité et les ressorts de l’humour pince-sans-rire.
« Ni plus ni moins », le dernier album de José Parrondo est tout simplement envoûtant. Vu de l’extérieur, il peut sembler anodin, avec sa couverture qui représente un gros nuage blanc, sur fond de ciel bleu, où deux bonshommes sans bras semblent scruter le plancher des vaches. Le trait naïf, l’écriture cursive, les à-plats de couleurs vives, tout cela doit sembler bien enfantin à la plupart des lecteurs. Et un coup d’œil rapide à l’intérieur du livre confortera sans doute cette impression. 46 planches de trois fois trois cases chacune, avec le même trait, les mêmes couleurs vives et les mêmes bonshommes, voilà qui ne semble guère passionnant. Eh bien, détrompez-vous, c’est exactement le contraire. Les 414 cases de l’album suivent les péripéties rocambolesques d’un bonhomme de neige, d’une bande de fourmis, d’un somnambule, d’un oiseau ou d’une camionnette de shampooing, dans un enchaînement hallucinant, qui semble réinventer les principes de la causalité et les ressorts de l’humour pince-sans-rire.
S’il s’agissait de résumer l’histoire, il suffirait de dire que l’assaut des fourmis sur un bonhomme endormi finira par entraîner la chute d’une montgolfière, ce qui ne révèlera rien du tout, si ce n’est la complexité de l’esprit du facétieux Parrondo, toujours prêt à rebondir à la case suivante dans un nouveau repli de son univers faussement enfantin. Il est bien difficile de mettre des mots sur un livre pareil. On se contentera de dire que le dessin et la narration, réduits à leur plus simple appareil, à leur essence presque, réussisse à emporter le lecteur dans un tourbillon quasi magique. Une prouesse que Lewis Trondheim, pourtant génial par ailleurs, ne parvient pas à réussir dans ses albums sans parole comme le tout récent « Mister I » publié chez Delcourt. José et Lewis ont bien des choses en commun, le premier est, avec cet album, passé maître dans l’art de la narration sans parole, le second reste à l’heure actuelle l’un des meilleurs dialoguistes de la BD française. On attend d’ailleurs toujours la suite de leur collaboration sur la série « Allez raconte ». Mais c’est une autre histoire.
« Ni plus ni moins », en tout cas, n’en raconte pas une seule mais des tas d’un coup. Et c’est aussi un objet magnifiquement réalisé. Chapeau aux Requins marteaux pour la qualité du travail éditorial !
José Parrondo, « Ni plus ni moins », Les Requins Marteaux, 2006. 46 planches couleur. 14 €
22:45 Publié dans Notes de lecture | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer

















